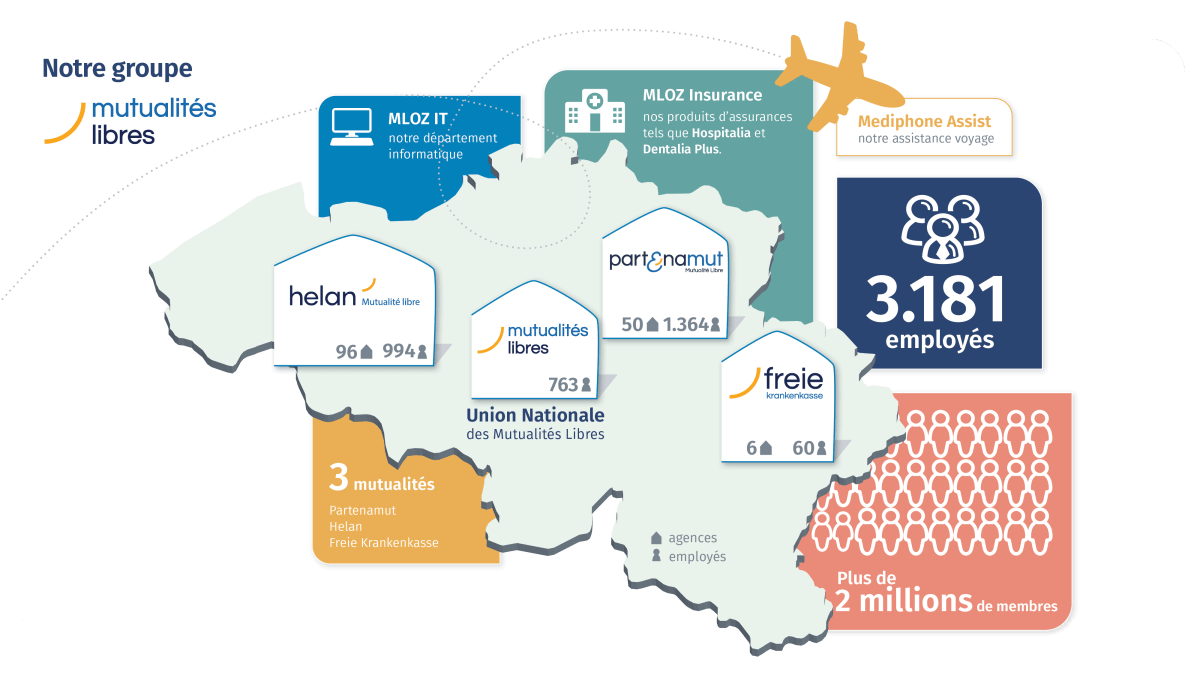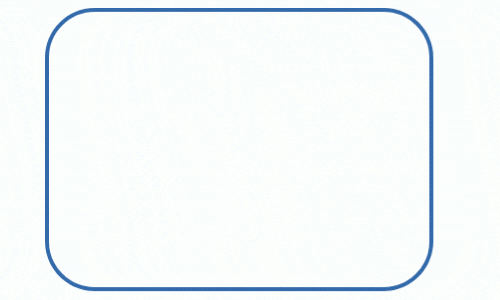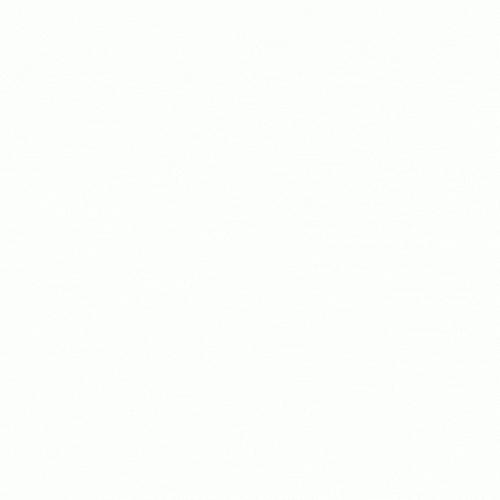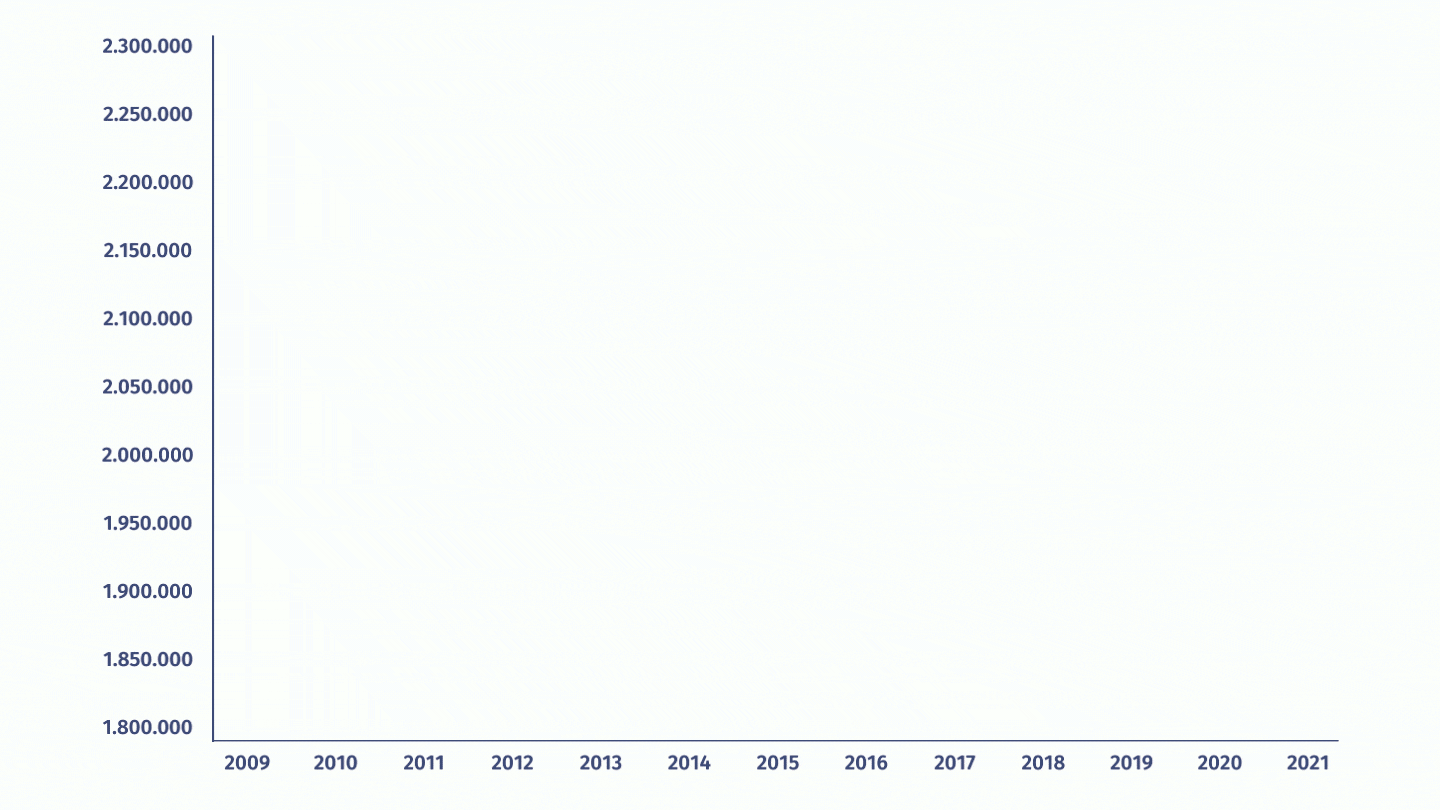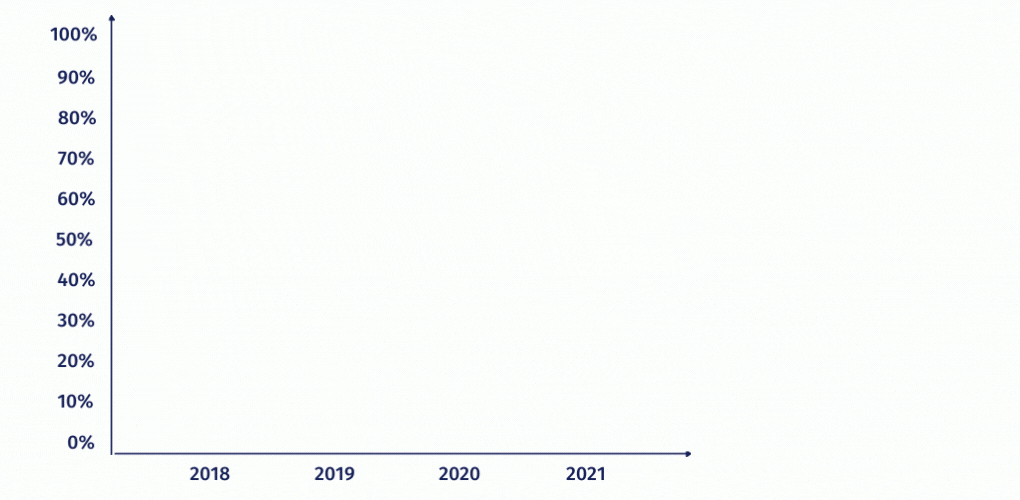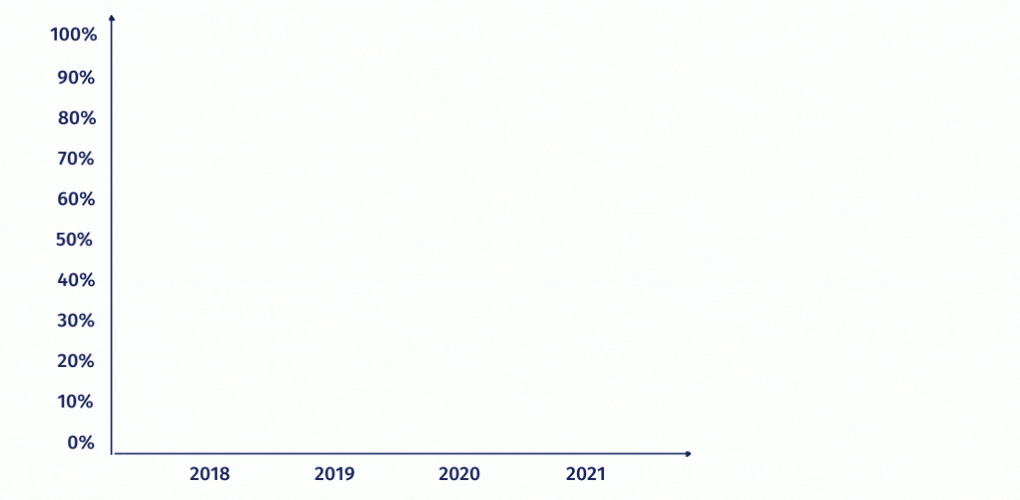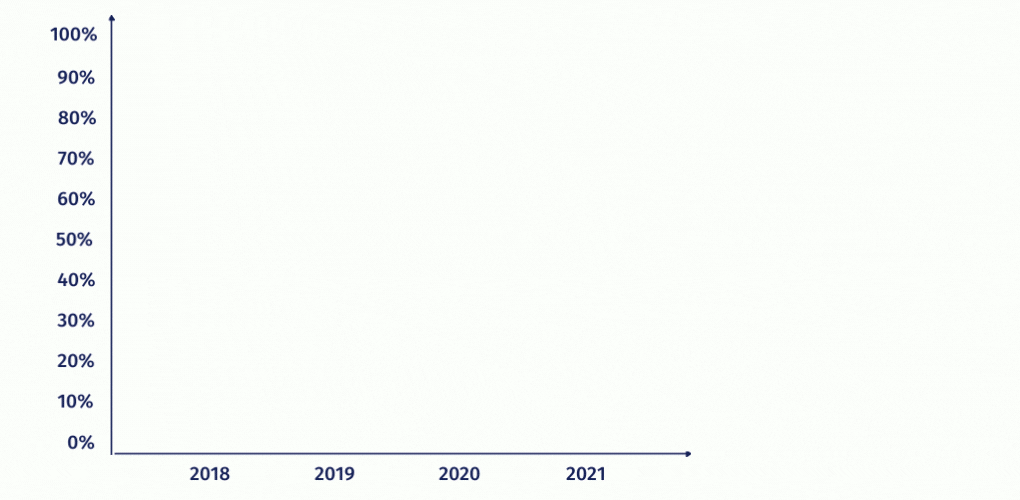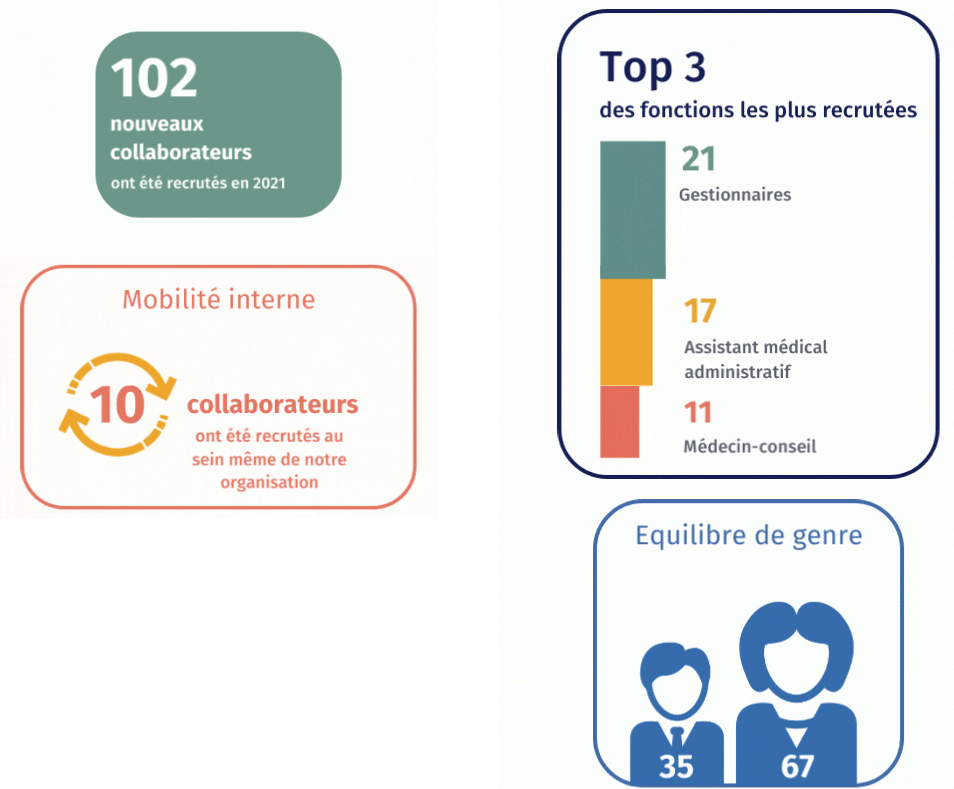Coalition Climat et marche pour le climat
La santé et le climat font partie des principales priorités des Mutualités Libres, qui ont traduit leur engagement en participant à la Coalition Climat, un vaste accord de coopération de plus de 80 organisations sociales. Le dimanche 10 octobre, des dizaines de milliers de citoyens inquiets, dont une délégation des Mutualités Libres, ont manifesté à Bruxelles contre le réchauffement climatique.
Principale exigence : une approche cohérente et transversale pour garantir la viabilité de la planète.
CurieuzenAir
Depuis octobre, l’Union et plus de 3.000 autres points de mesure à Bruxelles, participent à l'enquête citoyenne CurieuzenAir. Son objectif ? Mesurer la qualité de l'air dans ce qu'on appelle le "Pentagone" à Bruxelles, mais aussi dans les quartiers situés en dehors du ring. Les Mutualités Libres sont convaincues que la mobilité durable est la clé pour une meilleure qualité de l'air.
Wellbeing
Le groupe de travail interne Wellbeing a organisé de nombreuses activités pour maintenir un bon équilibre entre le corps et l'esprit.
Les sessions virtuelles de "Better Minds at Work" en ont été l’un des points forts. Question centrale : comment établir des liens plus étroits avec nos collègues et travailler de manière optimale à distance ?
Une attention particulière a également été accordée à la cohésion sociale par la mise en place d'une plateforme d'échange "CollaboraXion" sur l'intranet. Là aussi, l'accent était mis sur un travail hybride plus efficace et sur le fait de rester en contact avec les collègues.
Ces activités ont aussi reçu un accueil favorable en 2021 : séances de yoga, fitness via Teams et (en juin) une fête du personnel virtuelle sur le thème de la musique.
Inondations
Les énormes ravages causés par des inondations sans précédent dans le sud du pays n'ont pas laissé nos collègues indifférents. Le vendredi 6 août, en pleine période de vacances, plus de 80 bénévoles ont prêté main forte en nettoyant et en distribuant des repas dans la région liégeoise. Ils ont pu compter sur beaucoup de sympathie de la part des sinistrés.
Efforts de recyclage
A l’Union, le département logistique collecte chaque année plus de 700 kg de petits déchets et de déchets dangereux, tels que les appareils électroniques, les toners et les piles. ABa Recycling a récompensé ces efforts en nous décernant un "Green Feet Award".